Aperçus sur le bouddhisme theravāda: entretien avec Louis Gabaude

Réalisé par Manuel Olivares.
Ici la version anglaise originale.
Ici la version italienne.
Traduction et adaptation française: Louis Gabaude.
Présentation: Le bouddhisme dit “theravāda” ou “des anciens” est considéré par ses fidèles comme le plus proche de la tradition primitive. En Asie, on le trouve principalement aujourd’hui au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, en Laos et au Cambodge, tandis que de petites communautés subsistent aussi en Inde, au Népal, en Chine du Sud, au Vietnam et en Malaisie.
Louis Gabaude est un spécialiste du bouddhisme theravada d’Asie du Sud-Est.
Après avoir enseigné à l’Université de Chiang Mai, il entra à l’École française d’Extrême-Orient (EFEO). Il vit à Chiang Mai (Thaïlande) depuis 1974.
Voir la plupart de ses articles à: https://efeo.academia.edu/LouisGabaude
Pouvez-vous commencer par vous présenter?
Louis Gabaude – Je suis né dans le sud du Massif central. Mes grands-parents avaient une petite ferme dans les collines du massif granitique du Sidobre. Mon père, né en 1900, commença l’apprentissage de tailleur de pierre à 14 ans. A 20 ans, juste après la première guerre mondiale, on l’envoya faire son service militaire en Allemagne dans les “troupes d’occupation”. A son retour, il se mit à son compte et créa son propre atelier qui, après la seconde guerre, emploierait une vingtaine d’ouvriers. Malgré sa simple éducation primaire, il devint le maire de la commune, créa une association pour la protection de la région, et reçut une distinction académique. Mes parents eurent 5 enfants.
Né en 1942, j’étais le plus jeune, aimé de tous, et passai une enfance heureuse dans un environnement forestier. Grandissant après la guerre, je pus poursuivre mes études assez facilement, assumant la responsabilité de réussir des études supérieures qui avaient été refusées à mon père pour des raisons socio-économiques.
D’une certaine façon, pourtant, je n’étais pas préparé à la vie adulte parce que ma vie d’enfant avait été trop facile, trop douillette, alors que la vie adulte peut être dure, soit en raison de conditions externes, soit en raison de notre propre stupidité. La vie n’est pas faite pour les enfants béats.
Depuis la perspective que j’ai aujourd’hui, mon existence a peut-être été déterminée par une phrase que mon père aimait répéter : “Quand on a 20 ans, il faut quitter la France!”. Mes trois frères aînés quittèrent effectivement le sol métropolitain à 20 ans… pour leur service militaire, tout comme notre père avant eux. Mon tour d’avoir 20 ans arriva en 1962, juste à la fin de la “guerre d’Algérie“. Je choisis la version française du “Peace Corps“ américain copié par de Gaulle sur celui de Kennedy. En 1964, je fus envoyé au Laos après des études de philosophie et de théologie. J’avais 22 ans.
Je passai deux ans au Laos, à Pakxan, une petite ville endormie sur la rive gauche du Mékong, à 150 km à l’Est de Vientiane. J’enseignais le français dans une école secondaire mais mes élèves ont surtout retenu de moi mes leçons de guitare! Pendant ce service civil, les Américains commencèrent à bombarder le Nord du Laos et du Vietnam à partir de la Thaïlande, avec les résultats que l’on sait. Leurs avions nous survolaient en vrombissant vers le Nord. Je pouvais alors entendre des élèves vietnamiens murmurer en classe: “Go home!”. La guerre nous cernait d’un murmure continu. Le conflit ne m’affecta pas physiquement mais, psychologiquement et intellectuellement si. Je peux citer deux exemples simples.
Une bataille eut lieu à 25 km avec des victimes aussi bien chez les forces gouvernementales que dans les troupes communistes. Deux journalistes du Figaro décrivirent la bataille en rapportant, mettons, 10 morts chez les gouvernementaux, 10 morts parmi les troupes communistes lao, et 5 morts vietnamiens. Mais à Paris, la rédaction ne laissa mentionner que les victimes gouvernementales et celles des communistes lao. Il fallait sauvegarder la pureté de la révolution lao. Les soldats vietnamiens combattant aux côtés des communistes laotiens n’étaient pas politiquement corrects et ne pouvaient donc pas être relevés, même dans un journal de droite. Ce fut ma première leçon sur la relativité de la “vérité” publique médiatique.
Au cours des vacances de Noël, nous grimpâmes jusqu’à un village hmong qui avait été bombardé par les forces gouvernementales quelques semaines auparavant. Comme il y avait un tout petit poste de soldats communistes au col voisin, les militaires en avaient conclu que le village aussi était communiste, et ils le bombardèrent. Quand le gouvernement réalisa qu’ils avaient commis une erreur contre-productive, ils—ou les Américains—payèrent du matériel aux villageois pour les aider à reconsruire leurs maisons. Je voyais à quel point la guerre était cruelle pour les gens innocents, toujours victimes de quelque chose qui les dépasse.
Comment est né votre intérêt pour le bouddhisme theravāda?
Louis Gabaude – C’est à Pakxan que je commençais à être intrigué par le bouddhisme pour une raison très simple. J’apprenais la langue lao. Pendant les week-ends, je flânais dans la ville avec mon appareil photo et remarquai que les gens les plus disponibles pour parler avec moi étaient les bonzes parce qu’ils étaient libres et relativement à l’aise avec un étranger. En fait, même aujourd’hui, si vous allez dans un lieu non touristique, la plupart des gens ne feront pas beaucoup d’efforts pour commencer à parler avec un étranger de crainte de ne pas pouvoir converser. Or, non seulement les bonzes étaient moins réservés mais, au contraire, ils souhaitaient améliorer leurs capacités langagières et partager leurs connaissances. En conversant avec eux, mon intérêt pour le bouddhisme s’accrut. Je lus quelques livres et, revenu en France, je suivis des cours sur le bouddhisme et sur l’histoire et les civilisations de l’Asie du Sud-Est à l’École Pratique des Hautes Études, une “école” de formation à la recherche.
En 1970, je vins en Thaïlande pour étudier le thaï avant de retourner au Laos enseigner dans le cadre de la Mission catholique. Je me mariai en 1973 et m’installais à Bangkok pour enseigner à l’Alliance Française. En 1974, je pris un poste à l’Université de Chiang Mai. En 1975, j’obtins mon diplôme de l’École Pratique des Hautes Etudes avec une étude sur l’édification des stupas de sable. Peut-être savez-vous que—pour le nouvel an d’avril en particulier—en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, en Birmanie et dans le Sud du Yunnan, les bouddhistes édifient et offrent des stupas de sable. Pour ma recherche, j’avais sélectionné et traduit en français les textes en langues pāli comme en langues et écritures vernaculaires (lao, tham, lan na, thaï et thaï “khom”) qui exposaient les raisons “matérielles” et “spirituelles” du rite d’offrande des stupas de sable.
En 1979, je soutins ma thèse relative à la théorie de l’interprétation des textes bouddhiques d’un bonze moderniste thaï Buddhadāsa Bhikkhu (1906-1993) et, en 1980, j’obtins un poste de chercheur à l’École Française d’Extrême-Orient (EFEO), une institution créée en 1900 pour permettre à des chercheurs de résider sur le terrain extrême-oriental de leur recherches.
 Les stupas de sable constituent-ils une réminiscence des mandalas de sable du Tibet ?
Les stupas de sable constituent-ils une réminiscence des mandalas de sable du Tibet ?
Louis Gabaude – Pas vraiment. Près de la frontière thaïe du Cambodge et au Cambodge même, ils édifient certes des stupas de sable qui peuvent imiter des schèmes angkoriens. Angkor est parfois interprété comme une sorte de “mandaḷa”, mais “mandaḷa” est devenu une construction anthropologique occidentale, un schéma tibétain plaqué sur l’Asie du Sud-Est et souvent exploité sans tenir compte de ce que les gens d’ici pensent ou savent.
Sont-ils liés au concept d’impermanence?
Louis Gabaude – Oui! Le sable coule entre les doigts comme les sentiments entre les heures, les mois et les années. Les textes que je traduisis et commentai sont appelés “anisong“, d’un terme pāli/sanskrit signifiant “avantage”. La plupart de ces textes comportent deux niveaux : le premier cite des récits anciens empruntés à ce qu’il est convenu d’appeler le “canon” bouddhique (Tripiṭaka) ou à d’anciens commentaires de ce “canon”; le second donne des raisons spirituelles et matérielles d’offrir ces stupas.
La première partie—ou le premier niveau—explique comment, dans une vie antérieure, le futur Bouddha était un pauvre bougre bien incapable d’offrir un grand stupa au Bouddha de son époque. Tout ce qu’il pouvait faire c’était édifier un stupa de sable, ce qu’il fit. Voilà pourquoi, dans ses existences postérieures, il put renaître dans des familles nobles ou prospères pour finir comme Bouddha. Le propos de ces textes est d’encourager les gens à offrir ce type de stupa pour obtenir ce que, en termes “catholiques” on appelle “indulgences”, et ici “avantages”. Vous offrez des stupas, ou tout autre chose dont les bonzes ont besoin, et vous obtenez un bon karma, si bien que, dans l’avenir, vous bénéficiez d’une vie meilleure et pouvez même devenir un Bouddha. Cette astuce très “catholique”—qui a fondé la culture matérielle visible du bouddhisme d’Asie du Sud-Est—n’est évidemment pas soulignée par les bouddhistes occidentaux souvent issus de traditions protestantes. J’aurais pu approfondir ce type de recherche mais ma professeure de pāli me poussa à me tourner plutôt vers Buddhadāsa Bhikkhu. C’est ainsi que j’abandonnai l’étude des textes bouddhiques plus ou moins anciens et me consacrai au bouddhisme moderne. Peut-être aurais-je dû suivre mon inclination première parce qu’il y a ici tant de textes oubliés dans les bibliothèques des monastères auxquels presque personne ne s’intéresse aujourd’hui…
Vous êtes-vous intéressé aux cultures pré-bouddhiques de l’Asie du Sud-Est?
Louis Gabaude – Je ne puis revendiquer aucune expertise en ce domaine, mais j’ai quand même beaucoup lu à ce sujet. Vous ne pouvez pas étudier le bouddhisme contemporain si vous ignorez tout ce qui était lié—et est encore lié—aux “esprits”, aux réminiscences “brahmaniques” ou “pré-bouddhiques”, quelle que soit l’étiquette que vous leur donniez. Nous, Occidentaux, devons être très prudents à ce sujet. Comme notre cerveau reste chrétien, nous avons tendance à penser que les religions sont des jeux d’idéologies clairement distinctes. Si vous êtes chrétien, vous n’êtes ni hindou ni musulman; si vous êtes catholique, vous n’êtes pas protestant, etc. Nous nous fondons sur des catégories congelées, schématiques et clivantes.
La question banale qu’un Occidental pose en Thaïlande quand il voit des dieux “hindous” dans un temple “bouddhiste”, c’est : “Ces gens sont-ils bouddhistes ou hindouistes ?” Or, ici, le problème n’est pas là. Le Bouddha et les premiers bouddhistes vivaient avec une image indienne du monde et de la vie. Ils en avaient une vision “compréhensive” ou “inclusive” : vous êtes né aujourd’hui comme homme, mais demain vous renaîtrez peut-être comme ver, chien ou dieu. Les cycles de vies et de rétributions karmiques comprennent tous les modes possibles d’existence. Alors, même s’il y a des dieux “hindous” dans un temple “bouddhiste”, cela ne signifie pas que les dévots de ce temple se voient comme “hindous”. C’est simplement que ces dieux “hindous” sont juste des positions, des postes, toujours provisoires, attribués à un être vivant qui a mérité telle ou telle rétribution pour telle ou telle durée.
Comment ces divinités sont-elles considérées? Comme des esprits particulièrement développés par exemple?
Louis Gabaude – Prenez la racine du mot thaï “thewa”, venu du sanscrit “deva”, venu lui-même de l’indo-européen “dev”—lié à “lumière”—que nous retrouvons en grec comme “θεός”, puis en Latin comme “deus”, et finalement dans toutes les langues latines sous des formes voisines. Or, il y a une grande différence entre le “deva” bouddhiste généré dans le grouillement de la forêt tropicale sous un ciel couvert et le “Deus” chrétien généré dans le désert aride sous un ciel bleu ou étoilé. Pour faire simple, dans le bouddhisme, les “deva“ ne sont pas transcendants à ce monde. Ils font partie du cercle conditionné et vicieux des vies impermanentes, le saṃsāra. Ils ne correspondent en aucune façon à Deus/Dieu (avec un “D” majuscule), ou à Allah. Ici, on parle donc d’un “deva” conditionné—”contingent” en termes chrétiens—, avec un petit “d”, soumis à la loi des causes et des effets, alors que Dieu ou Allah sont pensés par définition comme étant au delà, ailleurs, dans l’indicible.
Peut-on alors leur attribuer une dimension métaphysique plutôt que théologique?
Louis Gabaude – Si vous voulez l’exprimer ainsi, oui, encore qu’une discussion sur ce que vous appelez “métaphysique” et “théologique” serait bien utile. Je le répète : il est important de souligner que nous parlons de “deva” avec un petit “d”. C’est la raison pour laquelle, par exemple, quand les premiers missionnaires vinrent ici et parlèrent de Dieu et du paradis, les bonzes ne comprirent pas du tout ces notions comme “transcendantes”. Pour des oreilles bouddhistes, leur discours chrétien ne désignait pas quelque chose de réellement transcendant, ultime, au delà des conditions, mais un simple “dieu” et un simple “paradis” banalement soumis à la loi des causes et des effets.
Votre approche du bouddhisme theravāda est-elle simplement celle d’un chercheur ou suivez-vous également les doctrines et pratiques bouddhistes?
Louis Gabaude – Je n’oserais dire que je suis chrétien ou bouddhiste. Chrétien pour quoi? Bouddhiste pour quoi? Fondamentalement, je suis sans doute chrétien et même catholique pourvu que vous ne me demandiez pas de signer chaque article du Credo. Je crois que, structurellement, comme tous les Européens, je suis chrétien et peux confesser que ce que j’ai de meilleur en moi vient du christianisme. Je ne parle pas des dogmes et des rites. Je parle de ce qui pour moi est essentiel dans le christianisme, à savoir: “Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit ne saurait aimer Dieu qu’il ne voit pas“. Je ne suis donc pas passé par la sorte de rejet du christianisme de beaucoup d’Européens qui ignorent tout simplement leur histoire culturelle, ce qu’ils sont, d’où ils viennent, et ce qu’ils seraient si le christianisme n’avait pas façonné l’Europe. Pourtant, je suis certainement influencé par le bouddhisme et suis devenu une sorte de métis culturel, un monstre peut-être! Dans mon cas, cela n’est pas forcément une surprise. Mon père, quoique catholique, était également imprégné de philosophie “païenne”, en particulier de son versant stoïque qui, soit dit en passant, avait fleuri de Bénarès à Rome. Ayant lu Epictète et Marc-Aurèle, il était notamment familier de l’observation selon laquelle il y a dans le monde deux catégories de choses : celles dont vous avez la maîtrise et les autres. Il est parfaitement vain de souffrir à cause de la seconde catégorie—les choses que vous ne pouvez pas changer. Chacun sait, par exemple, que nous mourrons un jour. Pourquoi en souffrir par avance ? Pourquoi inventer une souffrance morale ? N’est-ce pas tout simplement stupide? N’est-il pas mieux d’accepter la mort et de jouir du jour qui se lève? Mon père ne voyait donc pas de contradiction entre une perspective “religieuse” chrétienne et une perspective “philosophique” païenne. Elles jouaient simplement à des niveaux différents. De la même manière, le bouddhisme m’a appris à commencer par réfléchir sur la base de la vie telle qu’elle est. Ce que les bonzes enseignent à leurs ouailles est beaucoup plus simple que ce qu’un curé de paroisse enseigne aux enfants : vous êtes né, vous vieillissez, vous souffrez, puis vous mourez. Point final. C’est la première et, en un sens, toute la leçon du catéchisme bouddhique. Tous les autres discours découlent de cette simple considération pour poser finalement la question: que fait-on à partir de là ? Par contraste, la première leçon que je reçus au catéchisme chrétien fut: “Dieu est un pur esprit, infiniment bon et infiniment aimable, qui nous a créés pour l’adorer et le servir”. Voilà une “philosophie” dogmatique, imposée, artificielle, métaphysique, désincarnée, complètement étrangère à la vie quotidienne d’un homme, pour ne rien dire de celle d’un enfant. Dans ce sens, il est vrai que j’ai été beaucoup plus sensible au côté pratique du bouddhisme dont le point de départ est radicalement “existentialiste”.
Naturellement, je n’ai ni entériné ni singé aucune “conversion” sociologique. Les gens se disent “bouddhistes”, “chrétiens” ou “musulmans” par besoin d’identité sociale tout en prétendant parler de leur identité “spirituelle”. Cela finit par devenir étrange et même amusant. Si vous admettez que ces “religions” sont des méthodes pour parvenir à un certain idéal, à une certaine “perfection”, et si vous croyez que la perfection est un idéal qui ne peut jamais être complètement achevé mais simplement un objectif à poursuivre, alors le simple fait de vous appeler “bouddhiste”, “chrétien” ou “musulman”, implique que vous vous sentez satisfait et content d’avoir réalisé officiellement la plénitude d’un être “bouddhiste”, “chrétien” ou “musulman”, ce qui est en général une totale illusion. Ça marche pourtant parce que c’est une marque de satisfaction personnelle fondée sur le fait qu’on croit en quelques “vérités” et observe certaines règles qui nous distinguent des autres pour le plus grand bonheur de notre ego.
Regardez tout ce qu’on a fait et qu’on fait encore au nom du Bouddha, de Dieu ou d’Allah! Regardez combien vous décrochez dans vos tentatives d’ascension de vos idéaux! Alors, se définir comme “bouddhiste”, “chrétien” ou “musulman”, c’est tomber dans le piège, l’illusion, l’aberration d’une “perfection” prétendument achevée. A moins, naturellement, que, comme de vrais moines bouddhistes, vous sachiez que l’observation des règles n’est qu’un “entraînement” à quelque chose qui n’est pas encore acquis ou que, comme de vrais moines chrétiens, vous essayiez de vous “convertir”, jour après jour, à une perfection dont vous avez humblement conscience qu’elle n’est jamais achevée et doit être permanente.
Là, nous devons mentionner le cas des institutions. Il est dans la nature des idéaux religieux d’être matérialisés dans des institutions et, par la suite, plus ou moins fossilisés parce que, tôt ou tard, les gens tendent à œuvrer plus pour leur institution que pour son idéal. C’est du reste le sort commun à tous les projets humains et nous n’y pouvons pas grand chose : nécessaires à la survie de leur idéal, les institutions doivent en même temps faire face à leur sclérose, à leur érosion, à leur écroulement partiel ou total.
Quels types de différences avez-vous notés entre le bouddhisme theravāda du Laos et celui de la Thaïlande?
Louis Gabaude – La question du bouddhisme dans le Laos communiste est une question complexe. Au début, quand les communistes prirent le pouvoir en 1975, l’élite du Parti avait naturellement une grande foi dans la théorie marxiste/léniniste. Pour eux, la religion était “l’opium du peuple” et, par conséquent, quelque chose à supprimer. Ils étaient néanmoins réalistes et assez malins pour générer et promouvoir des penseurs qui théorisèrent que, jusqu’à présent, les “capitalistes” avaient exploité le bouddhisme mais que ce dernier pouvait être interprété dans un sens favorable aux classes exploitées. En même temps, ils étaient sceptiques sur la capacité du bouddhisme à résoudre les problèmes sociaux à la racine, contrairement au communisme de leurs rêves qui réglerait naturellement tout. Au cours des 10 premières années de pouvoir, ils prouvèrent et prirent conscience que leur expérience communiste était déjà un échec économique et que, en conséquence, ils devaient ouvrir leur économie tout en gardant habilement leur système politique bloqué si bien que le Laos est aujourd’hui une sorte de capitalisme économique sous couvert d’un état officiellement communiste, tout comme la Chine et le Vietnam voisins.
Ils découvrirent aussi que, après la fin de la monarchie, il n’y avait plus rien pour unifier le pays parce que la théorie marxiste/léniniste était trop récente, trop superficielle, trop en échec local et mondial pour restructurer et fidéliser profondément les mentalités. Ironiquement, ils réalisèrent alorsque le bouddhisme pouvait être un outil capable de cimenter et de motiver les esprits. Une sorte d’opium pour faire passer un autre opium peut-être ?
L’identification des gens avec la monarchie était-elle aussi forte au Laos qu’en Thaïlande?
Louis Gabaude – Non. En Thaïlande, jusqu’à nouvel ordre, la monarchie est beaucoup plus forte parce que l’unification nationaliste du pays est plus ancienne et assez efficace. L’une des grandes différences entre les deux pays est que, depuis le 19e siècle, le Laos, le Cambodge et le Vietnam ont été plus ou moins administrés par les Français qui n’étaient pas particulièrement intéressés par la doctrine et la discipline bouddhistes. Tout ce qu’ils demandaient c’était que les bonzes ne soient pas mêlés à des mouvements irrédentistes. Au Siam, en revanche, les rois se sont toujours personnellement impliqués dans le bouddhisme. Le cas extrême est celui du roi Mongkut—alias Rama IV (r. 1852-1868)—qui avait été bonze, et même réformateur, pendant presque 30 ans avant de monter sur le trône. Une fois roi, il ne pouvait naturellement pas se comporter comme un président français lointain et laïc. En Thaïlande, le roi et même le gouvernement se sentaient—et se sentent encore—obligés de garder un œil sur la façon dont le bouddhisme est administré, étudié et pratiqué. Au Laos, avant les communistes et en continuité avec la ligne française, le gouvernement n’intervenait pas si les bonzes n’étaient pas contre lui. Mais, de nos jours, les communistes lao tout comme les dirigeants thaïs—avec certes des moyens et des objectifs différents—cherchent tous à intervenir dans la gestion du Sangha, le corps des moines bouddhistes de leur pays respectif.
La coutume thaïe de passer une période au monastère bouddhiste n’est-elle pas obligatoire pour tous les rois?
Louis Gabaude – La tradition veut en effet que tous les jeunes gens deviennent moines pour une brève période de temps afin d’être “mûrs” ou “cuits” comme laïcs et prêts à “consommer” une épouse ou, pour un roi, un royaume. Rama IV avait été une exception avec son long séjour au monastère. Puisque le roi siamois est bouddhiste—c’est une obligation stipulée par les Constitutions modernes—et qu’il est le protecteur de la religion—et par extension des religions—, s’il pense que les bonzes ne se comportent pas correctement, il doit intervenir. Comme je l’ai dit, en Indochine, les Français n’étaient pas préoccupés par les arcanes internes du bouddhisme alors que, dans les traditions et les pays du bouddhisme theravāda, les rois ont toujours contrôlé la conduite des bonzes. Commençant au moins avec Ashoka (-304? -232) en Inde, ils ont défroqué des dizaines et des centaines de bonzes pour la raison ou le prétexte qu’ils n’étaient pas fidèles aux enseignements ou aux règles du Bouddha, comme si la religion était une question trop sérieuse pour être laissée entièrement aux mains des moines!
 On sait que la Thaïlande, avant d’être un pays bouddhiste, a été influencée par l’hindouisme. Pouvez-vous nous dire comment le bouddhisme s’est introduit dans le pays.
On sait que la Thaïlande, avant d’être un pays bouddhiste, a été influencée par l’hindouisme. Pouvez-vous nous dire comment le bouddhisme s’est introduit dans le pays.
Louis Gabaude – A ce jour, je ne sache pas que l’on puisse définir avec certitude un date pour l’arrivée du bouddhisme dans ce que nous appelons aujourd’hui “Thaïlande”. Cela dépend d’abord de ce que vous lisez, de qui écoutez, et aussi de quel bouddhisme vous voulez parler. Si vous écoutez les bouddhistes thaïs contemporains qui répètent leurs anciennes chroniques, ils sont sûrs que le bouddhisme arriva ici dès l’époque de l’empereur indien Asoka qui mourut en 232 avant notre ère. Ses envoyés dans notre Chersonèse—Suvarṇabhūmi—auraient introduit le bouddhisme juste là, à Nakhon Pathom, près de Bangkok, où le grand stupa reste la “preuve” monumentale de cet avènement. En revanche, si nous cherchons des preuves matérielles confirmées par les archéologues de la présence du bouddhisme theravāda dans le bassin de la Chao Phraya, nous devons attendre jusqu’à la période du 6e au 8e siècle pour trouver des inscriptions en langue pāli qui constituent des preuves raisonnables que la tradition theravāda y était alors bien active. Mais nous ne pouvons connaître ni la date d’un commencement précis, ni le point d’origine—Inde ou Sri Lanka—de cette “première” tradition. C’est seulement pour le bouddhisme theravāda que nous avons aujourd’hui ici que l’origine cinghalaise peut être attestée à partir du 13e siècle.
Avant le bouddhisme, les dirigeants exerçaient leur pouvoir à l’intérieur d’une image du monde “hindouiste”, au moins dans leur capitale et les principales cités. Même aujourd’hui, en Thaïlande, derrière le roi bouddhiste, vous trouvez des brahmanes. Sans eux, on ne peut consacrer un roi thaï bouddhiste à Bangkok. Les brahmanes y ont des obligations et des fonctions rituelles nécessaires au maintien de la monarchie. Maintenant, si vous me demandez si le paysan d’un village reculé vit sous l’influence du brahmanisme, je dirais que non. A la campagne, les gens croient aux esprits locaux. Lorsque la “religion” devient sophistiquée et se transforme en un appareil intellectuel, il faut établir une hiérarchie des pouvoirs. Les “esprits” ou “phi“ des villageois sont élevés au rang de “deva“, de “yakkha“, etc., qui prennent place dans les imaginaires “brahmanistes” et “bouddhistes”. Mais ce sont là des astuces ou des “moyens habiles” pour permettre aux esprits de la forêt et aux villageois de se situer dans le monde sur l’échelle de la rétribution karmique. Leurs esprits ne sont plus des créatures primitives grossières mais appartiennent désormais à l’univers hindou/brahmaniste/bouddhiste. Votre question trahit une évidence occidentale: nous appliquons un système de classification clivant et excluant. Ici, au contraire, l’environnement culturel est plus synthétique grâce à des systèmes religieux indiens inclusifs.
Alors, si j’ai bien compris, les influences brahmaniques jouent plutôt au niveau de l’élite…
Louis Gabaude – Quand elles sont systématisées, oui. On doit appartenir à une élite instruite pour connaître les textes, les rituels, les noms et les histoires de “dieux”, etc.; sinon, la plupart des gens les ignorent. Si vous emmenez un ou une thaï(e) dans une cathédrale en Occident, il/elle va allumer un cierge sans problème parce que, pour eux, c’est un moyen d’exprimer la même attitude dévotionnelle vis-à-vis de quelque chose qui demeure mystérieux et qui, en conséquence, peut être perçu et nommé différemment ici ou là. Ils ne le voient pas comme un élément “catholique” étranger à leur univers “bouddhiste”.
A propos de la Thaïlande, on utilise parfois le terme de “syncrétisme“, ce qui implique une sorte de mélange de croyances et de pratiques mettant en jeu des dieux hindous, des “esprits” et des éléments bouddhistes. Pour décrire les pratiques communes, je ne pense pas que “syncrétisme” soit correct car le terme implique que nous aurions des systèmes clos qui opéreraient ensemble. Or, nous en avons déjà parléà propos des esprits et des devas, le jeu n’est pas compris de cette façon ici.
Tous les êtres vivants sont recyclés dans le même système, le même cercle de vie, la contingence d’un monde conditionné radicalement différent du nirvana inconditionné. Une fois de plus, le terme “syncrétisme” vient d’une perspective chrétienne; c’est le produit d’une mentalité conditionnée par la conception excluante d’une “religion” ou d’une “foi”. Au cours des premiers siècles de son histoire, le christianise s’est construit comme un système de croyances exclusives monté avec le temps en dogmes si bien que, à la fin, si vous ne les admettez pas, vous n’êtes pas un “chrétien”. Dans le cas de l’Asie, on peut tolérer académiquement le mot “syncrétisme” du point de vue d’un observateur qui connaît les différents systèmes et qui les voit comme systémiquement différents, mais du point de vue des gens qui croient et vivent selon ces systèmes, “syncrétisme” n’est à mon avis pas correct.
Est-il correct, pour vous, d’en tirer des conséquences sur le plan psychologique? En d’autres termes, est-il correct de penser qu’en Asie les gens ont une psychologie différente en plus d’avoir une culture différente?
Louis Gabaude – Les hommes ont une tendance naturelle à identifier et confondre la réalité avec leurs propres conceptions de cette réalité. En Asie du Sud-Est, la plupart des gens ne conceptualisent pas ou ne théorisent pas beaucoup au delà de la théorie du karma selon laquelle rien n’arrive par hasard. Tout arrive par des facteurs multiples, mais des facteurs très “personnels” marqués, enregistrés, et disséminés tout au long du fil reliant nos innombrables existences. Habituellement, les gens laissent aux bonzes les explications sophistiquées. Ils luttent pour vivre en faisant de leur mieux pour jouir d’une vie décente et faire face aux problèmes élémentaires de l’existence. Ils n’ont pas une tendance exagérée à systématiser et rationaliser ce qu’ils font au delà de cette théorie élémentaire du karma. Ils réagissent jour après jour aux circonstances variées de leur existence et interprètent les événements comme des fruits de leur karma. Cette théorie totalisante est peut-être ce qui différencie les peuples indianisés des Occidentaux sur le plan psychologique: en Occident, nous cherchons toujours des causes externes à nos problèmes alors qu’ici ils savent que leurs propres actes étaient et sont à la racine de tout ce qui leur arrive. La raison de leurs échecs comme de leurs réussites peut être définie comme “intérieure” parce qu’elle relève de leurs actions passées ou récentes. En Occident, au contraire, nous tendons à toujours chercher des causes “externes” comme si nous n’étions jamais responsables de rien; hier, c’était Dieu ou le Diable; récemment, ça a été le capitalisme ou le communisme, ou un groupe ethnique, ou une nation, ou une religion; demain, quelque nouveau diable, toujours extérieur à nous-mêmes ou à notre groupe social, fera son apparition. Pour nous la théorie du karma est dépassée et nous rêvons à d’autres théories explicatives totalisantes. Même au travers de nos thèses universitaires et de nos travaux académiques, nous systématisons tout et cherchons partout un même facteur opératif : “structure”, “lutte des classes”, “pouvoir”, “sexe”, “capital” ou quelque autre hochet intellectuel du jour de telle sorte qu’au bout du compte la réalité doit rentrer dans le cadre—le hochet—que nous lui avons préalablement fixé. L’incidence de ces explications totalisantes—qu’elles soient “intérieures” ou “extérieures”—sur la psychologie des gens peut naturellement donner lieu à ample discussion.
Pour commencer, je ne pense pas que la discussion devrait parler de l’Asie comme d’un moule unique ou uniforme. L’Inde et la Chine sont très différentes. L’Asie du Sud-Est a emprunté aux deux, ce qui conduit évidemment à plusieurs types de psychologies dans un même pays.
 Pourriez-vous, s’il vous plaît, dire quelques mots sur des bonzes thaïs fameux comme Buddhadāsa Bhikkhu et Achan Cha ? Ce sont les plus connus en Occident. Y en a-t-il d’autres de moins connus qui méritent d’être mentionnés également?
Pourriez-vous, s’il vous plaît, dire quelques mots sur des bonzes thaïs fameux comme Buddhadāsa Bhikkhu et Achan Cha ? Ce sont les plus connus en Occident. Y en a-t-il d’autres de moins connus qui méritent d’être mentionnés également?
Louis Gabaude – Commençons par Buddhadāsa Bhikkhu (dans la photo). Beaucoup de gens en ont parlé. Je me suis intéressé à son rôle parce qu’il mettait en question l’image traditionnelle du bonze thaï. Buddhadāsa était un bonze “créatif” qui essaya de rendre le bouddhisme acceptable, “avalable”—ce sont ses termes—par la classe moyenne instruite de son temps. La renaissance, par exemple, pouvait paraître trop naïve ou incroyable, aussi la présenta-t-il comme une renaissance psychologique avec un sens métaphorique. Il fut donc accusé de nier la théorie de la renaissance “physique” et du karma courant sur plusieurs existences à quoi il répliqua qu’il ne la refusait pas mais la trouvait improductive, inutile pour la vie de chaque jour. Pour lui, les gens avaient besoin d’un bouddhisme utile ici et maintenant. Buddhadāsa était intéressant parce que c’était un homme du monde moderne essayant de réinterpréter sa vieille tradition d’une façon acceptable par un homme du monde moderne. Il tenta de le réaliser en retournant aux origines du bouddhisme, au moment où ce dernier n’était pas encore très institutionnalisé puisque la seule institution était le Sangha, la communauté monastique fraîchement créée.
 Achan Cha (1918-1992; dans la photo), disciple de Achan Man (1870-1948), avait une approche similaire, une attention similaire à l’origine du bouddhisme que l’on peut résumer ainsi: a. le Bouddha quitta le palais royal, commença à réfléchir sur la condition humaine et montra ce qu’il convient de faire pour être heureux dans le monde tel qu’il est; b. il identifia la solution comme étant la domination et le rejet des désirs puisqu’ils conduisent à des comportements stupides et conduisant au mal-être; c. la façon radicale d’y parvenir est de devenir moine mendiant et de consacrer son temps à observer ce qui se passe dans l’esprit à chaque instant. Buddhadāsa comme Cha insistèrent sur le besoin de retourner aux origines. La différence, c’est que Buddhadāsa fut sollicité pour parler à des membres de l’élite de la classe moyenne tandis que Cha se consacra à la création d’une communauté de moines fidèles à la stricte discipline et à la méditation. Il s’exprimait en langage traditionnel tandis que Buddhadāsa essaya de communiquer d’une façon plus moderne, avec souvent des termes anglais.
Achan Cha (1918-1992; dans la photo), disciple de Achan Man (1870-1948), avait une approche similaire, une attention similaire à l’origine du bouddhisme que l’on peut résumer ainsi: a. le Bouddha quitta le palais royal, commença à réfléchir sur la condition humaine et montra ce qu’il convient de faire pour être heureux dans le monde tel qu’il est; b. il identifia la solution comme étant la domination et le rejet des désirs puisqu’ils conduisent à des comportements stupides et conduisant au mal-être; c. la façon radicale d’y parvenir est de devenir moine mendiant et de consacrer son temps à observer ce qui se passe dans l’esprit à chaque instant. Buddhadāsa comme Cha insistèrent sur le besoin de retourner aux origines. La différence, c’est que Buddhadāsa fut sollicité pour parler à des membres de l’élite de la classe moyenne tandis que Cha se consacra à la création d’une communauté de moines fidèles à la stricte discipline et à la méditation. Il s’exprimait en langage traditionnel tandis que Buddhadāsa essaya de communiquer d’une façon plus moderne, avec souvent des termes anglais.
Que pensez-vous du socialisme dharmique de Buddhadāsa?
Louis Gabaude – Il fut accusé d’être communiste mais son “communisme” était une fiction! L’accusation vint principalement du fait qu’il pensait et affirmait que les gouvernements anticommunistes étaient “immoraux”: comment donc pouvez-vous bombarder le Nord-Vietnam au nom de la morale, demanda-t-il aux Etats-Unis ? Une seconde et plus subtile raison était que son apparente négation de la renaissance physique constituait un refus implicite du modèle hiérarchique et karmique d’une société où chacun acquiert sa position sociale grâce à son karma. Mais au delà de ces similarités, Buddhadāsa n’avait aucune foi dans le communisme ou dans les régimes communistes parce que ces derniers aussi étaient “immoraux” ou “a-dharmiques”. Il donnait des raisons pour lesquelles les gens se tournaient vers le communisme mais il ne pensait pas que le communisme pouvait être la vraie réponse. Finalement, disait-il, le communisme ne serait qu’une ride mineure vite effacée sur la plage de l’histoire. Une histoire qui, d’ailleurs, commença à lui donner raison de son vivant même.
Dans le monde bouddhiste et quelquefois chez Buddhadāsa lui-même, on trouve une tendance à considérer que le Vinaya, la règle des moines bouddhistes, est un modèle de société “socialiste”, ce qui pour moi, est totalement anachronique et structurellement absurde. Nous ne devons pas oublier que le Bouddha quitta le palais royal: voilà le point de départ, l’acte primal du Prince Siddhartha précédant et conditionnant son accès à la bouddhéïté. Il était d’abord et avant tout un renonçant, un “sâdhu“ qui commença par quitter la politique. Aussi, considérer que la communauté monastique, le Sangha, est un modèle de société laïque est totalement incohérent. Certes, le Sangha n’est pas hors du monde ou physiquement séparé de la société mais il se constitue de fait et par essence en dehors des règles habituelles et normatives du monde que sont le travail, les classes sociales et la reproduction sexuée. Le seul lien structurel entre le Sangha et le monde est la mendicité, ce contact obligé et quotidien entre un ou une laïque et le bol à aumônes. C’est un lien qui, paradoxalement, exprime le caractère étranger du moine libéré de toute obligation sociale “mondaine”. Certes, en Inde tous les renonçants vivaient et vivent encore en principe dans un groupe libéré de la caste mais le Bouddha ne prétendit pas abolir les castes ou les classes sociales en dehors de ce groupe, dans la société en général. Ce n’était pas son affaire. Un livre très intéressant à lire est “Sâdhus” de Patrick Lévy qui devint lui-même un sâdhu pendant un ou deux ans en Inde. Sa lecture permet de comprendre ce qu’était le bouddhisme à son origine puisque c’est ce type de vie que le Bouddha et ses disciples menaient.
Les bouddhistes qui soutiennent que la communauté monastique est le modèle d’une société égalitaire font l’impasse sur le premier moment du bouddhisme: comme renonçant ou sâdhu, le Bouddha rejeta toute responsabilité mondaine dans le maintien de cette société mondaine. Certes, au cours de l’histoire, les communautés monastiques—bouddhistes comme chrétiennes d’ailleurs—ont influencé leurs société environnantes respectives mais non pas en tant que modèles d’organisation structurelle. Certes encore, les communautés monastiques—bouddhistes comme chrétiennes—sont peut-être le seul endroit où le communisme est réalisé, mais cela n’est possible précisément que parce qu’elles ne jouent pas selon les règles du monde laïc. C’est la raison pour laquelle les prendre comme modèle de ce monde laïc constitue une proposition non seulement invalide mais complètement irréaliste.
 Outre Buddhadāsa Bhikkhu et Achan Cha, on trouve beaucoup d’autres moines célèbres ou influents, mais il y en a un dont j’aimerais dire un mot: Prayut Payutto (dans la photo), né en 1938. Pour moi, il incarne en Thaïlande le modèle du moine theravāda. Il connaît parfaitement la doctrine (Dharma) et la discipline (Vinaya) tels que le bouddhisme theravāda les a transmis et compris jusqu’ici, sans compromissions avec les modes modernes. Il est la voix de cette tradition. D’une certaine manière, il est donc la voix du Bouddha. On peut se risquer à le comparer à un Henri de Lubac (1896-1991) en théologie catholique ou à un Karl Barth (1896-1968) pour le protestantisme. A une différence fondamentale près : dans le christianisme, les grands théologiens peuvent reformuler périodiquement le système théologique puisque Jésus ne l’a jamais fait. Dans certaines limites, ils sont libres de le faire et même encouragés. Dans le bouddhisme theravāda, au contraire, comme l’on considère que le Bouddha a tout formulé parfaitement une fois pour toutes, les maîtres theravāda ne peuvent que retourner au système prétendument “originel”, le rappeler, mais en aucune façon le reformuler. Prayut Payutto est parfois accusé d’être trop conservateur par certains observateurs occidentaux mais comment peut-on être un moine theravāda sans être “conservateur” puisque cette branche du bouddhisme se considère comme le laboratoire de conservation du bouddhisme des anciens (thera)? Reprocher à un moine theravāda d’être conservateur est donc complètement absurde.
Outre Buddhadāsa Bhikkhu et Achan Cha, on trouve beaucoup d’autres moines célèbres ou influents, mais il y en a un dont j’aimerais dire un mot: Prayut Payutto (dans la photo), né en 1938. Pour moi, il incarne en Thaïlande le modèle du moine theravāda. Il connaît parfaitement la doctrine (Dharma) et la discipline (Vinaya) tels que le bouddhisme theravāda les a transmis et compris jusqu’ici, sans compromissions avec les modes modernes. Il est la voix de cette tradition. D’une certaine manière, il est donc la voix du Bouddha. On peut se risquer à le comparer à un Henri de Lubac (1896-1991) en théologie catholique ou à un Karl Barth (1896-1968) pour le protestantisme. A une différence fondamentale près : dans le christianisme, les grands théologiens peuvent reformuler périodiquement le système théologique puisque Jésus ne l’a jamais fait. Dans certaines limites, ils sont libres de le faire et même encouragés. Dans le bouddhisme theravāda, au contraire, comme l’on considère que le Bouddha a tout formulé parfaitement une fois pour toutes, les maîtres theravāda ne peuvent que retourner au système prétendument “originel”, le rappeler, mais en aucune façon le reformuler. Prayut Payutto est parfois accusé d’être trop conservateur par certains observateurs occidentaux mais comment peut-on être un moine theravāda sans être “conservateur” puisque cette branche du bouddhisme se considère comme le laboratoire de conservation du bouddhisme des anciens (thera)? Reprocher à un moine theravāda d’être conservateur est donc complètement absurde.
A côté de ces moines de l’élite et des maîtres de méditation qui ont acquis une certaine réputation même en Occident, la plupart des membres du Sangha thaï assurent discrètement le fonctionnement du système. Ils gèrent le bouddhisme tel qu’il est. Et les bouddhistes, tels qu’ils sont, se révèlent souvent surprenants aux yeux des innocents: ils demandent du confort matériel alors que le Bouddha y renonça; ils demandent des talismans alors que le Bouddha répétait que chacun est son propre refuge; ils demandent à ne pas mourir alors que le Bouddha insista sur la normalité de la mort; ils demandent les paradis alors que le Bouddha y échappa; ils demandent l’effacement du mauvais karma alors que la loi du karma est immuable. Et ainsi de suite. Aussi, parler de Buddhadāsa, de Cha, de Prayut, ou des maîtres de méditation n’est pas erroné mais peut nous faire oublier la majorité des bonzes qui font leur devoir ordinaire en répondant aux besoins des bouddhistes ordinaires. Malgré les scandales d’ordre sexuel ou financier exposés dans les médias, ils continuent de maintenir la structure qu’on peut appeler “spirituelle” de la société. Pour combien de temps? Voilà la question.
On trouve aussi des femmes qui animent des groupes de méditants. Cela est assez nouveau parce que, voilà 50 ans, il n’y avait pas beaucoup de gens pour passer deux, trois jours ou une ou deux semaines dans des sessions de méditation près d’un maître. Nous ne parlons pas assez de ce phénomène ici mais il est bien vivant.
Etes-vous un méditant ?
Louis Gabaude – Pratiquer la méditation bouddhique c’est comme faire des gammes pour un musicien. Or, à moins d’être Bach, les gammes ne sont pas la musique. Ces sessions de méditation sont des exercices d’entraînement au contrôle de l’esprit afin de l’empêcher de tomber dans les pièges multiples des désirs variés. C’est utile et probablement nécessaire, mais personnellement, à ce point de ma vie, je n’éprouve pas le besoin de m’asseoir pour ce type de session. Il est bon naturellement que les gens le fassent mais ils le revendiquent souvent avec une sorte de vanité discrète qui mérite un sourire tout aussi discret. S’ils ont compris ce qu’ils font, pourquoi s’en vanter ? Ne vaudrait-il pas mieux le laisser éventuellement percevoir par leur façon de vivre? Certes, la méditation est ou devrait être une pratique thérapeutique, tout d’abord en Occident où nul ne prend une seconde pour réfléchir à la façon dont on pense, ou aux raisons profondes pour lesquelles on pense ce qu’on pense. Personnellement, j’ai été formé comme chrétien. J’en ai pratiqué la méditation qui, quoique très différente, est également un moyen de contrôler son esprit en le maintenant sur la voie de l’idéal. J’ai également beaucoup réfléchi aux choses stupides que j’ai faites, aux sources de mes souffrances. Je ne sens pas aujourd’hui la nécessité de m’asseoir pendant une heure à observer mes inspirations et mes expirations. J’essaye d’observer mes propres paroles et attitudes, ainsi que celles des autres, avec un regard aussi froid et distancié que possible. J’essaye d’observer mon esprit à chaque moment, à chaque situation, quand quelque chose d’habituel ou d’extraordinaire se produit. Au volant, à table comme au lit. Car c’est à chaque instant de la vie que vous devez être capable d’exercer le jugement dont les bouddhistes disent que vous l’apprenez ou le mettez en pratique quand vous méditez. Pensez-vous que le Bouddha avait l’intention de former des gens simplement pour qu’ils s’exercent dans des conditions artificielles? Simplement pour le plaisir un peu maso de faire des gammes répétées à l’infini? Ici, quand les bouddhistes disent qu’ils “pratiquent” (patibat), c’est pour dire qu’ils font une session ou une séance de méditation. Je préfère penser que c’est la vraie vie qui est la vraie pratique. L’entraînement à la méditation ne peut être justifié que s’il a pour but d’enseigner à faire face aux événements quotidiens, aux émotions quotidiennes, aux gens que l’on rencontre tous les jours, de telle sorte que, par delà les gammes, nous sachions finalement comment transformer notre vie en vraie musique.

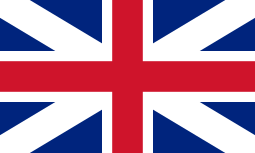 English
English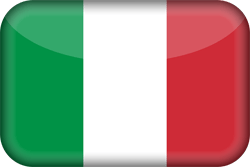 Italian
Italian